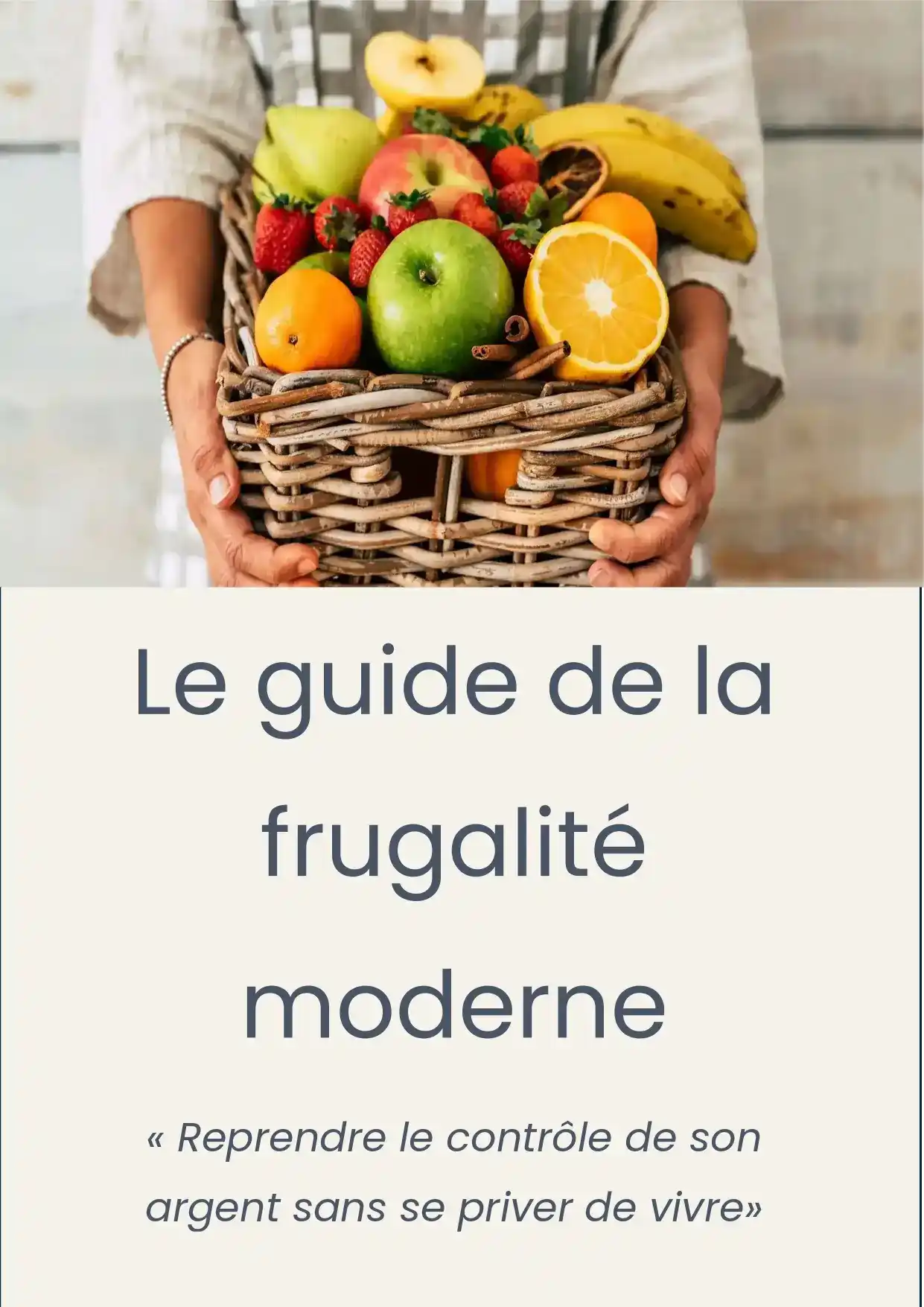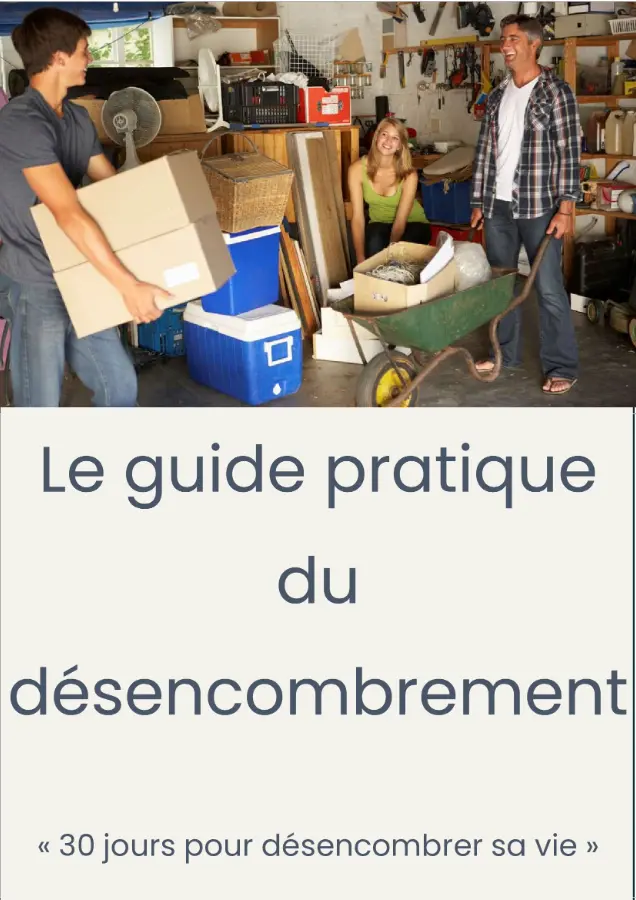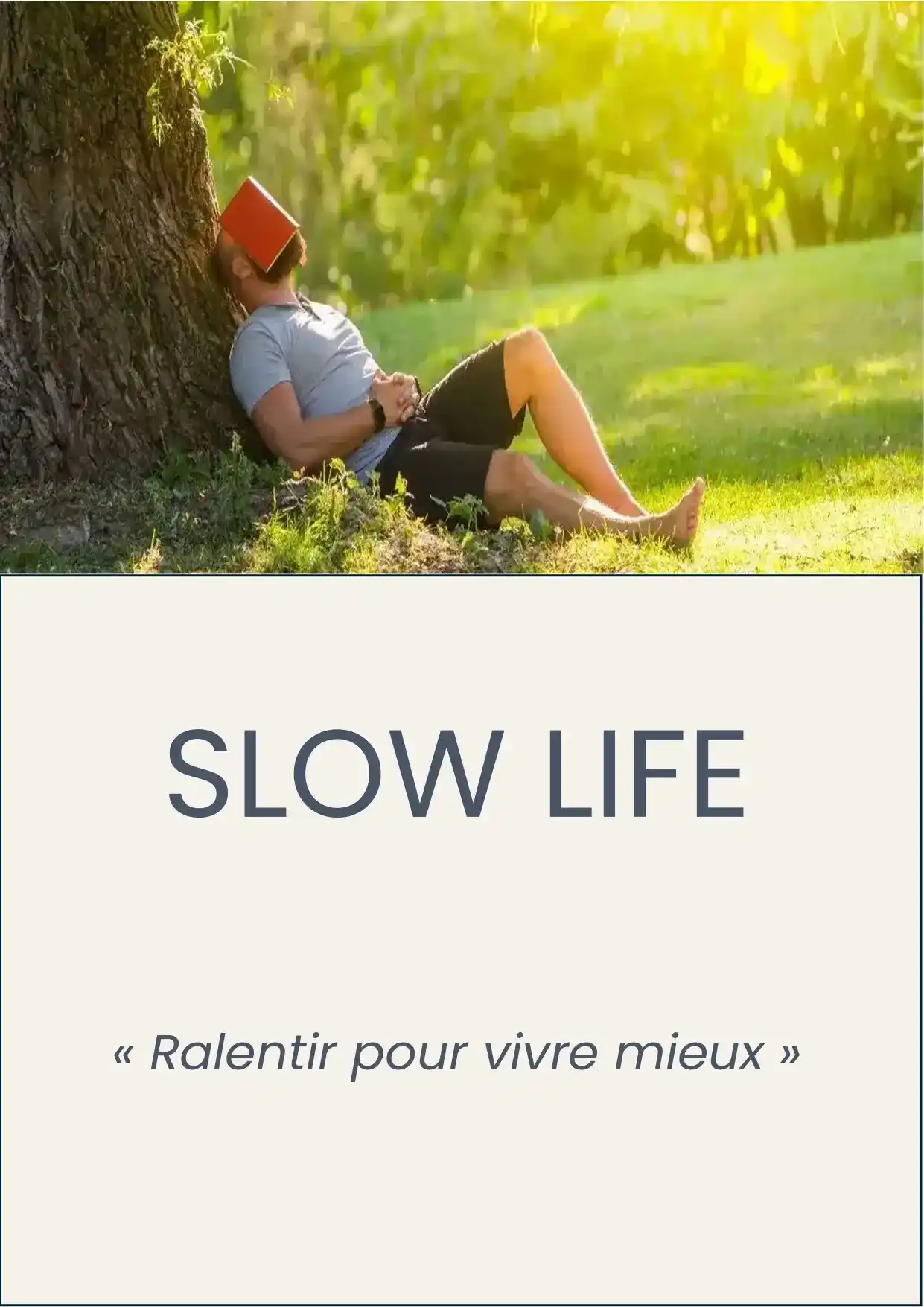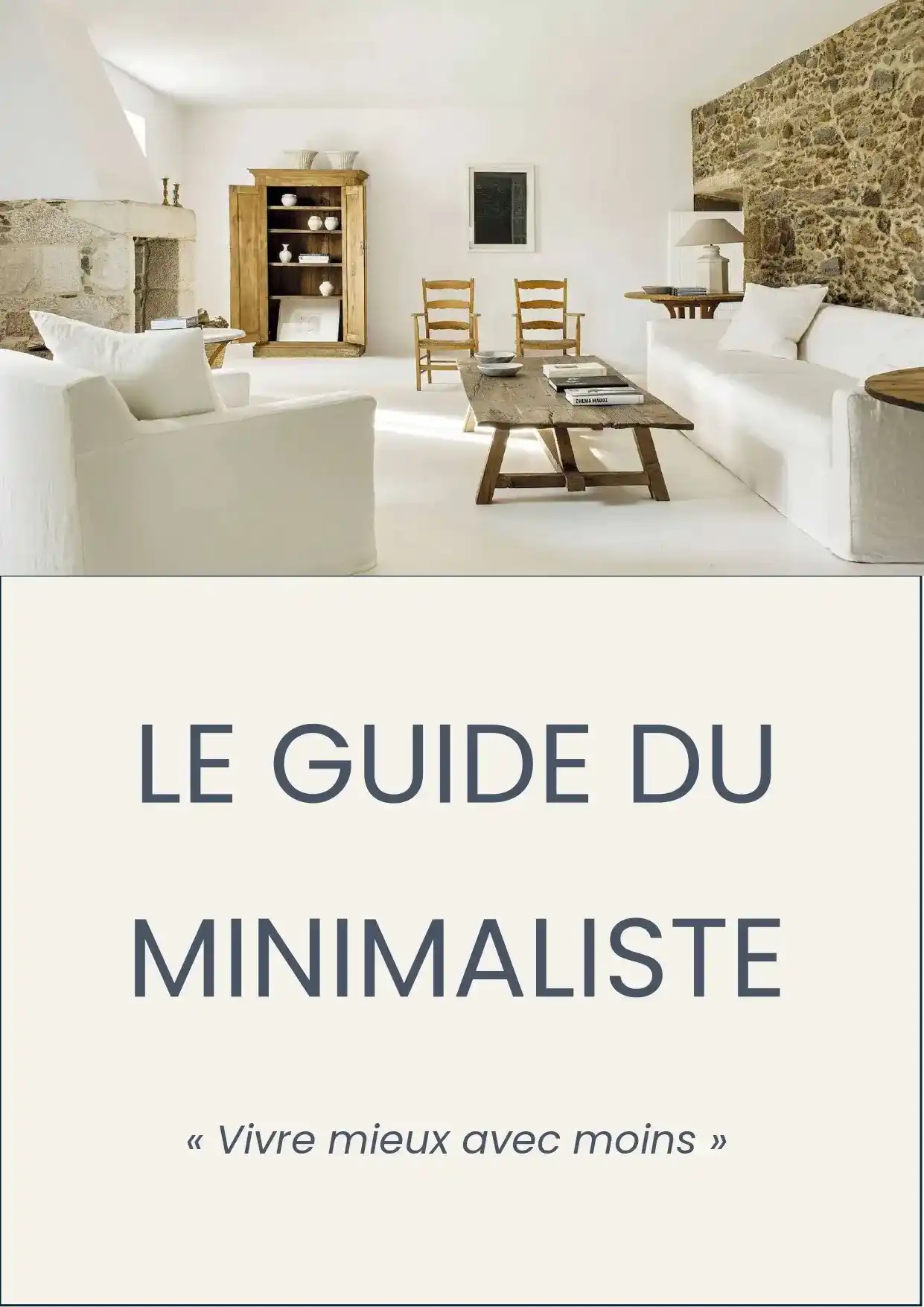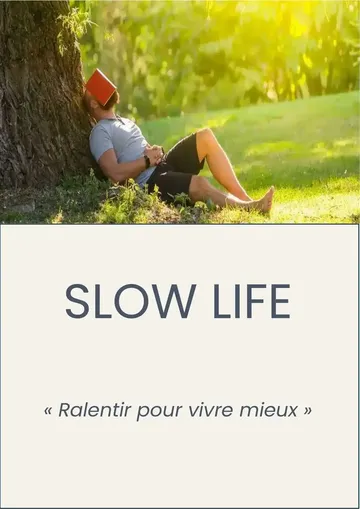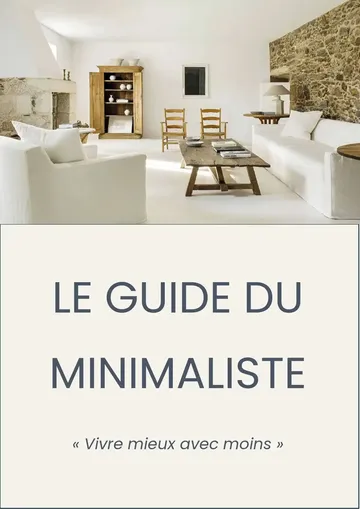L'extrême frugalité est-elle une maladie mentale ?

La frugalité peut être une force. Mais quand devient-elle préoccupante ?
Vous aimez dépenser avec intention, éviter le gaspillage, choisir la qualité plutôt que l’accumulation : rien d’alarmant là-dedans. La frugalité est un choix de vie. La question surgit quand l’économie devient une peur de dépenser, quand elle isole, ou quand elle fait souffrir. À ce stade, on ne parle plus d’un style de budget… mais d’un possible trouble sous-jacent.
Frugal ≠malade : où passe la ligne ?
Il y a problème quand cela fait mal ou dérègle votre fonctionnement (travail, santé, relations). Exemple : vous différez des dépenses indispensables comme les soins, l’alimentation correcte, la sécurité, alors que vous en avez les moyens.
L’idée de payer pour vous (ou pour les autres) déclenche angoisse, culpabilité, rumination.
Votre entourage évite de faire des projets avec vous par crainte de conflits d’argent.
Vous gardez des objets usés “au cas où” et jetez rarement, au point d’encombrer l’espace.
Si vous vous reconnaissez dans plusieurs points, il y a un sujet à explorer.
Il n’existe pas de diagnostic nommé “extrême frugalité”. En revanche, certains troubles peuvent inclure une relation problématique à la dépense :
Trouble de la personnalité obsessionnelle-compulsive (OCPD): parmi ses critères possibles figure un “style de dépense pingre envers soi et les autres”, l’argent étant perçu comme devant être thésaurisé pour des catastrophes futures. Ici, la rigidité dépasse la simple prudence et empoisonne la vie quotidienne.
Trouble d’accumulation (hoarding) : autre tableau, axé sur la difficulté à se séparer des objets et le désordre envahissant, ce n’est pas de la frugalité, mais cela peut coexister chez certaines personnes. Le critère central est l’impossibilité de jeter malgré une faible valeur perçue, avec détresse et logement encombré.
L’idée à retenir : épargner n’est pas pathologique. Ça le devient quand la peur, la rigidité et l’isolement prennent le dessus.
Il n’y a pas une cause unique. Parfois, c’est un choc financier passé qui laisse une empreinte, parfois une anxiété plus globale(besoin de contrôle, peur du manque). Les chercheurs montrent aussi que la rareté perçue (d’argent, de temps) peut rétrécir notre “bande passante” mentale et pousser à des décisions défensives, peu adaptées au long terme.
Notez pendant 7 jours les dépenses évitées et l’émotion associée (peur, culpabilité, contrôle). L’objectif n’est pas de se juger, mais de repérer les déclencheurs.
Définissez trois dépenses non négociables (santé, alimentation de base, liens sociaux simples). Les honorer régulièrement dessert l’angoisse.
Exemples : inviter un proche à un café, remplacer un équipement usé qui vous ralentit. L’idée n’est pas de “craquer”, mais de réapprendre des dépenses utiles sans panique.
Si l’anxiété reste forte ou altère vos relations, parler à un professionnel (médecin, psychologue, thérapeute financier) peut aider à démêler les causes et à travailler la souplesse (TCC, psycho-éducation, travail sur les “scripts d’argent”).

En résumé : la frugalité saine libère, l’extrême frugalité enferme
La frugalité, bien posée, agrandit la vie : plus de marge, moins de bruit, des choix plus clairs. Quand elle devient peur de dépenser, rigidité et isolement, on n’est plus dans la prudence : on est dans une souffrance qu’il est légitime d’accompagner.
Accordez-vous une dépense utile et modeste (santé, outil qui vous fait gagner du temps, moment avec un proche) et observez ce qui se passe en vous, sans vous forcer au-delà du raisonnable.
Si l’angoisse déborde malgré tout, faites-vous accompagner. Ce n’est pas “abandonner la frugalité”, c’est retrouver une frugalité qui vous respecte.